

novembre 2019
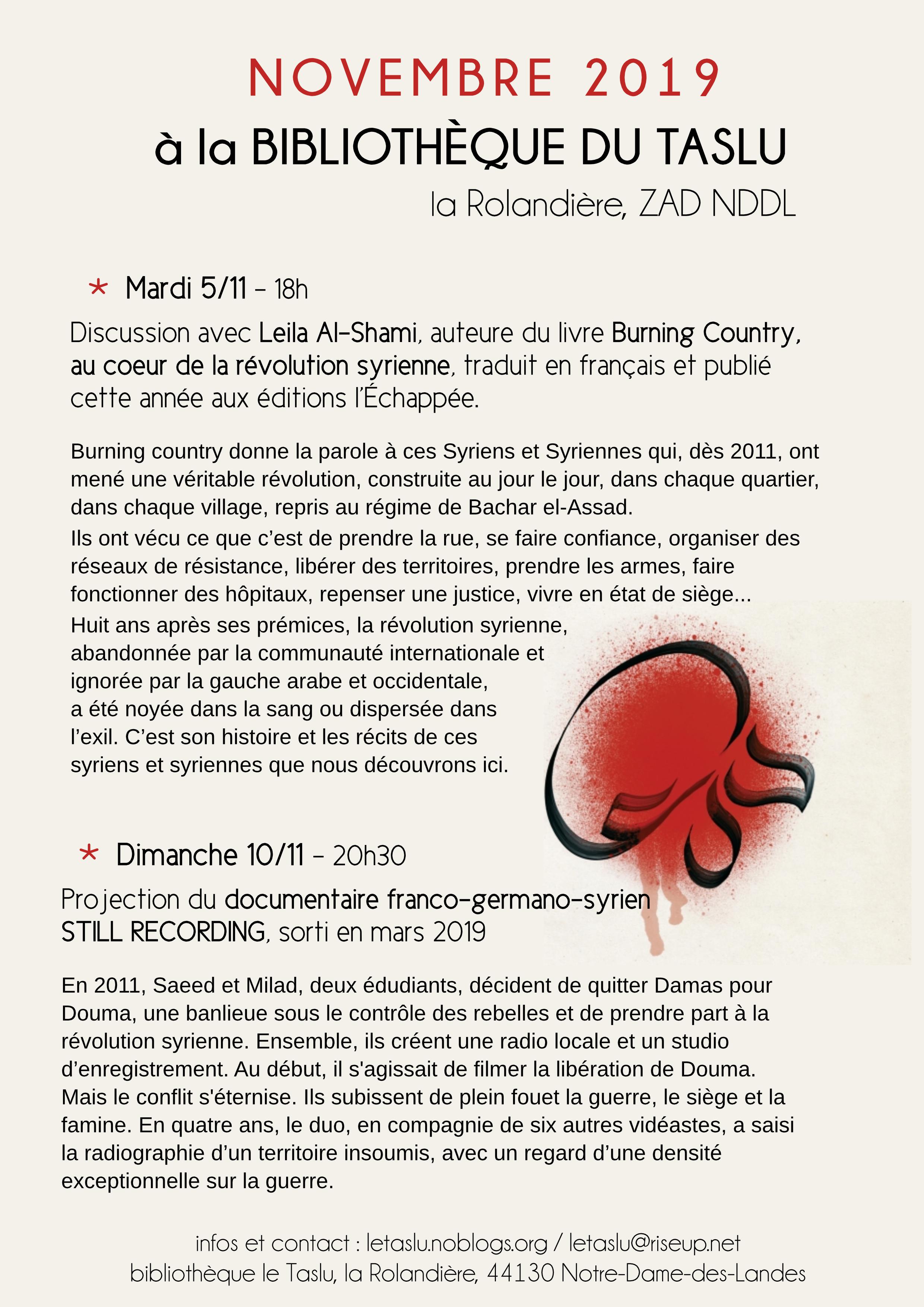
Samedi 26 octobre à 17h à l’Ambazada, expo photo et présentation du livre ‘Carnets de la ZAD’ de Philippe Graton
A l’occasion de la prochaine grande mobilisation autour des enjeux du foncier sur la zad le samedi 26 octobre (plus d’info ici), Philippe Graton, qui a parcouru la zad depuis 2014, viendra présenter son ouvrage de photographies, Carnets de la zad, paru aux éditions Filigranes ce 24 septembre.
Vous trouverez un aperçu de ce bel ouvrage ici : https://www.filigranes.com/livre/carnets-de-la-zad/

quelques images de ce beau moment dans la cabane de l’Ambazada :






Et maintenant ? L’hypothèse des communs
« Ce qui nous est commun, ce qui fait commun, ce sont bien les processus de réinvention du réel que nous amorçons ensemble et qui, en retour, nous obligent collectivement. »
P. Nicolas-Le strat
« Nous préférons parler de « résurgence » des communs, comme ce qui revient après éradication ou destruction. »
I.Stengers & S. Gutwirth
14h Première partie
Le travail du commun, une échappée grâce à laquelle imaginer un avenir contre et hors du capitaliste et de l’État ?
17h Seconde partie
Quels rapports au droit pour des zones ou des territoires en recherche d’autonomie ?
Isabelle STENGERS & Serge GUTWIRTH
« Il n’y aura pas de solution Larzac à Notre-Dame-des-Landes », telle fut la sentence sans appel du gouvernement Macron dès l’abandon du projet d’aéroport. Contrairement à l’expérience aveyronnaise, les formes de propriété qu’il entend imposer sur le bocage devront effacer en tout point les 40 années de lutte commune et hisser haut le retour à la normalité et à l’individualisme. Isabelle Stengers et Serge Gutwirth font partie de ceux qui depuis leur statut de philosophe et de juriste se sont insurgés contre cette négation :
« [La zad est] un de ces milieux auxquels un droit intrinsèque devrait être reconnu. Ce droit appartient à l’avenir. Peut-être les juristes pourront-ils concocter une de ces fictions dont ils ont le secret. […] Pourquoi une forme de personnalité ne pourrait-elle être attribuée à ces milieux que nous pourrions appeler « génératifs », parce qu’ils génèrent des relations, des sensibilités nouant les humains et les non-humains qui le composent et lui appartiennent. »
Nous qui ne faisons pas partie de ce monde des juristes et qui nourrissons une hostilité viscérale vis-à-vis de l’État et de ces institutions, ne sommes guère enclins à « revendiquer » un encodage de la zad dans le vocabulaire législatif. Que cela ne soit pas l’un de nos mots d’ordre n’induit pourtant pas que nous nous opposions à ce que le rapport de force de la lutte vienne se sédimenter dans des changements de propriété foncière qui nous seraient plus favorables. Le bureau d’autodéfense administrative de la zad a d’ailleurs œuvré dans ce sens durant des mois, avec pour objectif d’accroître les limites juridiques qui s’opposeraient à de nouvelles velléités étatiques de venir anéantir nos manières de vivre. Si nous nous « compromettons » en jouant avec le droit et les institutions ce n’est donc jamais par goût, mais bien parce que là résident parfois les ultimes barricades d’un territoire autonome. L’histoire de la lutte contre l’aéroport l’a largement démontré. Ce serait un grand manque d’humilité que de prétendre que cette mauvaise fréquentation est pour nous sans risque, qu’il n’y aurait dans ce contact aucun danger d’être subvertis. Cela en serait un plus grand encore de prétendre pouvoir survivre en nous passant de ce jeu dangereux. Accroître notre acuité au piège qui parsème cette relation devient donc vital, voici une des raisons pour lesquelles nus avons invité Isabelle Stengers et Serge Gutwirth, auteurs d’un article intitulé « Le droit à l’épreuve de la résurgence des commons ». Ils y explorent la difficulté d’articuler le droit en vigueur avec ce qu’exige la vie des communs. Ils nous expliqueront comment le fait quecette vie génère nécessairement le développement de droits coutumiers est au cœur d’une tension fondamentale avec le principe de la prééminence de la loi et du droit.
Pascal NICOLAS-LE STRAT
Une propriété collective serait certes un écrin confortable pour les communs, mais son absence ne signe pas forcément leur disparition ou leur impossibilité. Une sanction juridique n’est jamais qu’une prise, sur laquelle des territoires aspirant à l’autonomie peuvent parfois s’appuyer. C’est notamment ce que font beaucoup de peuples indigènes en Amérique latine. Arturo Escobar, lors de son dernier passage au Taslu, nous a notamment détaillé le jeu subtil qu’entretiennent les Afro-descendants en Colombie avec la loi 70 qui leur octroie des territoires communaux.
Car la réalité coutumière des communs, si elle est impactée par son statut légal, est finalement relativement indépendante des emprises juridiques. Voilà pourquoi l’État, en plus de nous refuser toute entité collective, voudrait nous voir nous muer en véritables chefs d’exploitations. Il aspire en définitive à assécher ce mauvais exemple qu’est la zad. C’est que nos communs sont des communs en résistance. C’est que notre commun est « un travail ». C’est du moins ainsi que le décrit Pascal Nicolas-le Strat en opposition à ces « biens communs » qui représenteraient la portion congrue de ce que le capitalisme n’aurait pas encore totalement subsumé : l’air, l’information, la lumière… De ces ressources il ne sera pas question ici. Si nous parlons de communs, c’est que ce pourrait bien être en leur nom que se mèneront les révoltes de demain, y compris une nouvelle défense de la zad.
« Le commun parvient, et à caractériser les logiques qui nous portent tort, et à impulser les alternatives dont nous avons besoin. Il joue en contre et en pour. Il intègre un rude motif d’opposition mais ne s’y laisse pas enfermer. Le risque est en effet réel pour un mouvement d’opposition de s’auto-entretenir et de s’auto-alimenter essentiellement dans et par son opposition – une opposition qui finit par devenir à elle–même sa justification et se referme comme un piège politique, empêchant le mouvement de maturer, de cheminer et d’ouvrir des perspectives. […] Le travail du commun ne s’interrompt pas dans le moment de l’antagonisme ; il se prolonge, il se sublime lui–même dans un moment positif et affirmatif par une capacité, jamais démentie, à imaginer. […] L’expérimentation peut tout à fait se concevoir comme le régime « normal » et ordinaire d’une politique du commun. Le commun n’est jamais définitivement acquis, il est sans cesse remis en chantier et réinstallé sur l’établi de nos désirs et de nos utopies. »
C’est une piste qui est tracée ici, une piste le long de laquelle nous pourrions apprendre nos propres manières de durer, à la lisière de l’État, les façons d’expérimenter à perpétuité, et d’instituer sans fonder d’institution. Pendant des années, la zad a duré en s’ancrant à l’opposition au projet d’aéroport, elle s’est bâtie dans sa rythmique, dans ses équilibres autour de cette pierre angulaire. Une fois celle-ci évanouie, d’autres équilibres, d’autres tensions, sont à inventer et à construire. D’autres projections aussi, non pas de lendemains qui chantent, mais de ce au nom de quoi nous désirons encore changer les choses. Ces communs, nous les façonnons dans un environnement politique qui les a jadis éradiqués et qui leur reste totalement hostile.
Vendredi 29 juin à 18h présentation de « Fukushima et ses invisibles »
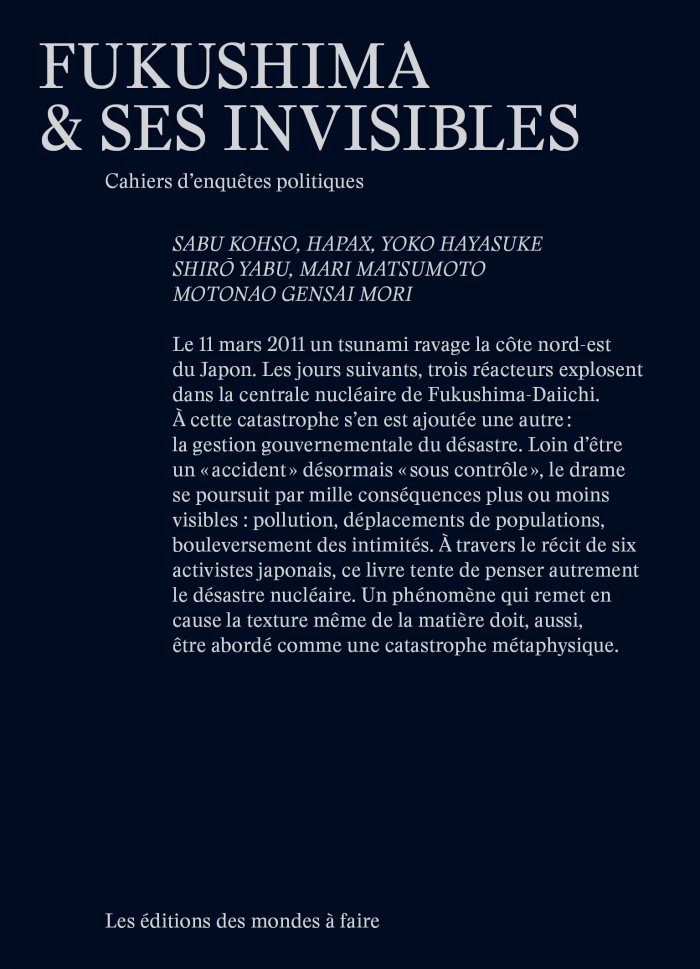
Sept années se sont écoulées depuis les explosions de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi. Et la catastrophe se poursuit. Chaque jour, des nucléides radioactifs se déversent dans l’air, l’eau et le sol. Pire, ce processus est amplifié par la politique du gouvernement japonais, qui distribue dans le monde entier des produits alimentaires irradiés, et force les principales municipalités du pays à prendre en charge les déchets radioactifs (notamment sous forme de remblais). Le gouvernement libéral démocrate persiste dans sa posture pronucléaire, proréarmement, et promarché. Dans le même temps, les initiatives populaires se multiplient pour protéger les corps, les esprits et l’environnement : relevés de la radioactivité par divers collectifs de mesures, évacuations volontaires, batailles juridiques, blocages, manifestations et actions de rue. Mais l’élan de ces luttes a été insuffisant.
L’accident de Fukushima a suscité d’innombrables discours. Face à l’urgence et à l’ampleur du désastre, la plupart d’entre eux ont façonné l’idée d’une « Crise Humaine » que réglerait une solution unique, une sorte d’union sacrée des dirigeants, des partis, des mouvements sociaux, dépassant les distinctions de classe et de caste. Mais le « problème Fukushima » n’est pas social ou politique ; il s’apparente plutôt aux « hyper-objets » conceptualisés par Timothy Morton. Il implique des choses, des temporalités et des échelles spatiales qui échappent en grande partie aux humains et qui pourtant leur sont intimement présentes : trou noir, biosphère, système solaire, plutonium, uranium.
Le désastre nucléaire est irréversible et conduit à deux pertes fatales pour les êtres planétaires. Par leur pouvoir de mutation et de destruction des processus génétiques, les nucléides radioactifs réduisent les possibilités du futur. Tôt ou tard, nous serons tous irradiés ! Et de ce fait, c’est notre lien à la terre, autrefois considéré comme le fondement des « communs », qui est touché. Autrement dit, les radiations n’atrophient pas seulement les ressources, mais aussi nos aspirations, notre capacité à créer des « communs ».
La présentation du livre aura lieu en présence de certains des auteurs et d’autres camarades japonais.
Jeudi 28 juin 20h30 : projection du film – Qui a volé le chaudron ?

(Fiction – 2h10. 2017)
À la Rolandière la présentation du film aura lieu en présence de plusieurs membres de l’équipe de production
Un vieux proverbe japonais dit : « Quand la lune est brillante, le kama est arraché. » Cela signifie que c’est précisément lorsque vous pensez pouvoir baisser la garde que vos objets précieux sont susceptibles de vous être volés. Un kama est une grande marmite utilisée pour la cuisson du riz qui, depuis la nuit des temps, revêt une importance à la fois pratique et symbolique dans la vie quotidienne au Japon. C’est le même kama dans Kamagasaki, que l’on peut traduire littéralement par « le couvercle du chaudron ». Ceux qui connaissent le quartier de Kamagasaki à Osaka l’appellent « Kama ». On dit qu’il s’agit d’une zone autrefois marécageuse, reconquise à l’époque d’Edo. Pendant la croissance économique de l’après-guerre, Kamagasaki devint un bidonville pour la population excédentaire du Japon, qui s’y installa pour travailler comme travailleur journalier pour les industries de la construction, du transport maritime et du nucléaire. Depuis lors, son nom a pris une nouvelle signification, car le kama, ou marmite à riz, peut facilement être associé à la population massive d’habitants de Kamagasaki qui vivent au jour le jour dans le quartier. Aujourd’hui, l’une des activités les plus importantes de la communauté de Kamagasaki est la soupe populaire qui se déroule dans le parc principal, Sankaku Koen. Là, un couple d’énormes kama sont utilisés pour cuire le riz et la soupe à distribuer à ceux qui ont faim. Si ces gigantesques kama servent simplement à première vue d’instruments de cuisine, on peut aussi leur attribuer une fonction magique, comme une marmite de sorcier servant à protéger les travailleurs journaliers et à exorciser la gentrification du quartier. C’est cette fonction qui inspire la prémisse farfelue du film : une grande guerre des chaudrons, dans laquelle les habitants de Kamagasaki se disputent le pouvoir symbolique et magique du chaudron.
Présentation du quartier de Kamagasaki
L’histoire se déroule à Kamagasaki, le yoseba [lieu de rassemblement] des travailleurs journaliers d’Osaka. Les travailleurs journaliers constituent la strate de la population à qui le Japon doit sa prospérité économique d’après-guerre, ce sont aussi ceux qui sont les plus gravement exclus de la société civile. Les hommes attendent tous les matins le recrutement par des sous-traitants illégaux (yakuza), prenant des emplois précaires sans avantages sur les chantiers de construction, les ports ou les centrales nucléaires, tandis que de nombreuses femmes vendent leur corps et leur esprit à l’industrie des services, y compris celle de la prostitution. Les habitants de Kamagasaki sont constamment exposés à l’exploitation violente par les yakuzas, à l’oppression de la police et à l’expulsion par les urbanistes. Malgré ou à cause de ces conditions extrêmes, les yosebas ont été des lieux de construction singuliers d’autonomie et d’entraide – et d’émeutes périodiques ! Ce film est un hommage au pouvoir de Kamagasaki, le plus grand de tous les yosebas au Japon, comme une comédie carnavalesque qui se déroule autour de son nom.
